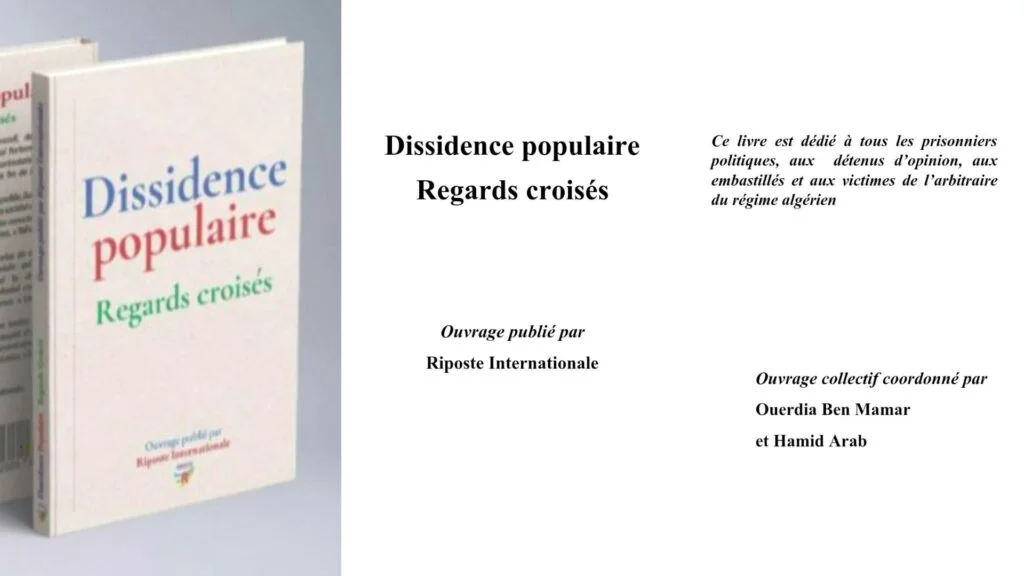
L’Algérie est régulièrement secouée par des mouvements sociaux d’ampleur variable depuis, notamment 1980. Mais l’insurrection citoyenne de février 2019 s’en distingue par son ampleur, son cours pacifique, sa radicalité, en quelques mots, il s’agit bien d’un mouvement sui generis qui se ressource à l’histoire de la guerre d’indépendance et se différencie tant des mouvements de contestation antérieurs que l’Algérie a connus que des « printemps » arabes.
L’une des principales raisons de ce soulèvement tient précisément au grand décalage entre la société, dont le niveau culturel et de conscience politique est en évolution constante depuis, notamment l’ouverture, bien qu’éphémère, du champ politique et médiatique en février 1989, et le régime politique qui, malgré quelques changements en apparence, est resté figé dans le temps, alors qu’il est censé accompagner la société dans son aspiration profonde au changement. Rétif à toute forme de souplesse de nature à lui permettre de s’adapter à des situations nouvelles, sa rigidité risque de le condamner à l’effondrement. La principale menace qui pèse sur le régime est, pourrait-on dire, le régime lui-même. L’instinct de conservation est si fort au sein des élites dirigeantes qu’elles sont devenues sourdes aux attentes de la société si bien qu’elles se sont montrées à plusieurs occasions (1965, 1979, 1988, 1992, 1999, 2001…) peu favorables à la réforme. Le cœur du drame algérien réside précisément dans l’incapacité des dirigeants à donner une traduction politique aux refus, aux angoisses et aux attentes des citoyens. D’où cette fois-ci la radicalité de la position des Algériens qui ont exigé clairement la rupture avec le régime et ses hommes : « Yetnahaw gaâ !» ce qui signifie littéralement « ils seront tous dégagés ».
La colère des Algériens qui a libéré une énergie débordante et inattendue tient à un double facteur. Le premier est immédiat ; il est directement lié à l’annonce faite par les dirigeants du FLN le 9 février 2019 à Alger de la candidature de Bouteflika, un homme âgé, impotent, usé par vingt ans d’exercice autoritaire du pouvoir, pour un cinquième mandat en présentant de surcroît un cadre à son effigie. Cette candidature absurde, tant sur la forme que sur le fond, est en quelque sorte la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, elle est vécue par l’écrasante majorité des Algériens comme un affront, une humiliation collective de trop. Le second est médiat ; il renvoie à toutes les luttes démocratiques, sociales et syndicales des décennies précédentes, notamment les luttes sociales des deux dernières décennies qui sont les incubateurs de l’énergie citoyenne des manifestants qui a forcé l’admiration des peuples un peu partout dans le 14 monde. Les dirigeants (haut commandement de l’armée, chef d’État et gouvernement) doivent bien prendre conscience que ce soulèvement citoyen est de nature révolutionnaire, mais pacifique, et ce pour plus d’une raison.
D’abord, la radicalité de ses instances qui exigent, non seulement, la démission – acquise – de Bouteflika dès le 2 avril 2019, mais avec une rupture radicale avec le régime politique. Autrement dit, son essence est éminemment politique, ce qui dément les clichés réduisant ce soulèvement exclusivement à sa dimension sociale et le distingue fortement des révoltes antérieures dont le caractère est, à quelques exceptions près, bien souvent social. Or ce soulèvement est porteur d’un idéal politique fondateur en ce sens qu’il postule un changement de régime, c’est-à-dire le passage d’un régime militaire à habillage civil à un État civil fondé sur les bases d’un État de droit. Et c’est bien ce profond désir de changement, clairement revendiqué, qui caractérise toute révolution. Cette épaisseur fait défaut aux simples révoltes que l’Algérie a connues jusque-là. Bien souvent, celles-ci sont de nature socio-professionnelle, régionale ou sociale. Or, en clamant sans détours la rupture avec le régime, l’un des grands mérites de ce soulèvement est d’avoir aussi réussi à dépasser le caractère social habituel des revendications, somme toute légitimes, portées jusque-là par différents mouvements sociaux, qu’à fédérer les Algériens dans leur grande diversité en revivifiant singulièrement le lien national.
Depuis son déclenchement tout converge et tout concourt dans toutes les actions, banderoles, pancartes, mots d’ordre… pour faire nation. Les manœuvres de division, de provocation et de récupération ont toutes échoué, bien qu’elles n’aient pas manqué tout au long de ce soulèvement. Une prise de distance avec l’islam politique est observée depuis les « printemps » arabes du début de la décennie 2010 ; ces derniers ont bien montré que les slogans islamistes sont en berne et l’islamisme a, par conséquent, cessé de s’imposer comme la modalité privilégiée par laquelle s’exprimait généralement la contestation politique et sociale. Le désintérêt à l’égard de l’islamisme se vérifie d’autant plus dans les pancartes et banderoles brandies régulièrement lors des manifestations, en rupture avec les slogans habituels des islamistes, comme « dawla islamiya », (État islamique) « qalla allah qalla al rassoul : seule la parole de Dieu et celle du prophète compte », « ‘alayha nahya ‘alayha namut : pour la cause de dieu nous vivrons, pour elle nous mourrons »… que la contestation politique a germé, cette fois-ci, non pas dans les mosquées, mais essentiellement dans les stades de football. Le fruit en germe dans ces terrains de sport où des milliers de supporteurs scandaient depuis au moins cinq ans des slogans hostiles au régime a pleinement éclos dans les rues depuis février 2019.
Du côté du régime, les manœuvres visant à faire échec à la révolution se traduisent par la propagande puisant 16 dans le vieux registre de la manipulation tantôt par l’État profond, c’est-à-dire le Département du Renseignement et de la Sécurité (l’ex-DRS), tantôt par la main de l’étranger, formulation itérative aux contours brumeux pouvant désigner la France, le Maroc ou certains États du Moyen-Orient… Puis l’agitation de la « menace Kabyle » en procédant à l’arrestation de plus d’une soixantaine de jeunes manifestants arborant l’emblème amazigh (berbère), la mystérieuse « opération zéro Kabyles », lancée lors d’une rencontre tenue du 18 au 20 août 2019 dans l’Ouest du pays (1 ), et la fermeture d’une douzaine d’églises en Kabylie (2 )… Désormais, cette région, surveillée de longue date par le pouvoir comme du lait sur le feu, est plus que jamais tenue en suspicion. Une région qui s’est engagée d’autant plus massivement dans ce soulèvement qu’elle le vit comme une continuité de ses luttes antérieures. De même qu’il ne peut être qualifié raisonnablement de mouvement acéphale, c’est-à-dire dépourvu de structures, de leaders ou de représentants ; d’où, pour certains, son inefficacité immédiate puisque le régime n’a pas été défait et la transition démocratique ainsi que l’État de droit, tant réclamés, ne sont pas à l’ordre du jour. Ce sont autant de critiques dont ce soulèvement est quelquefois justiciable, or s’il est bien vrai qu’il n’est pas structuré, ce soulèvement est, en revanche, organisé. Sinon comment expliquer le fait que les Algériens battaient le pavé tous les mardis et vendredis par milliers pendant plus d’un an s’il était à ce point sans têtes.
Dans une réflexion lumineuse sur ce thème précisément, le politologue Rachid Ouaissa(3 ) a bien montré comment ce soulèvement sort des sentiers battus en s’écartant nettement des théories classiques des mouvements sociaux. Cette forme d’organisation horizontale, caractéristique de certaines communautés berbères d’Afrique du Nord, est favorisée par la possibilité de communication qu’offrent aujourd’hui les réseaux sociaux et d’autres moyens de communication moderne qui permettent d’autant plus de s’organiser sans, physiquement, se rencontrer que l’Algérie compte près d’une vingtaine de millions de comptes Facebook.
Cette forme d’organisation, inhabituelle, présente surtout l’avantage d’éviter de faire courir des risques aux représentants et animateurs du hirak d’être facilement identifiés, ce qui les exposeraient plus aisément aux arrestations, infiltrations ou à d’autres pratiques corruptives du régime, comme ce fut le cas du mouvement citoyen des Archs en 2001 dans la région de Kabylie. Pour autant, cela n’a pas empêché des centaines d’arrestations et de condamnations, bien que celles-ci n’ont pas réussi à entraver le cours normal du mouvement. Ce serait se méprendre que de confondre structuration et organisation. À la verticalité oppressante de l’armée, dont le chef de l’État et son gouvernement dépendent étroitement, répond en miroir une horizontalité énergique et fascinante de ce mouvement qui n’est pas, non plus, une révolte sociale passagère qui rappellerait les émeutes que l’Algérie a connues au cours, notamment de la décennie 2010. Les révoltes sociales se comptaient alors chaque année par plusieurs milliers si bien que l’on a pu parler de naissance d’une « culture » de l’émeute(4 ).
Autre trait, ce soulèvement a jailli des entrailles de la société, il est strictement endogène si bien qu’il échappe totalement autant au contrôle des partis, syndicats, associations… algériens, bien que toutes ces organisations y soient présentes, qu’à l’emprise d’organisations étrangères. Mieux, il s’oppose à toute ingérence étrangère d’où qu’elle vienne, qu’elle soit d’ailleurs en provenance de certains États du Moyen[1]Orient (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Égypte…), de la France ou d’autres États de l’Union Européenne ou d’Amérique. Les États partenaires de l’Algérie soutiennent ouvertement, comme la Russie, la Chine… ou moins explicitement, à l’exemple de Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar… ou encore la France et l’extrême prudence de sa position officielle, le régime algérien. Seul le Canada a choisi d’apporter son soutien à une transition démocratique (5 ) favorable au hirak.
À y observer de plus près, l’on peut sans peine constater qu’il s’agit bien d’une révolution par son ampleur sans précédent, d’une part, puisque toute la société, quasiment, s’est soulevée non seulement pour empêcher un cinquième mandat brigué par Bouteflika, mais pour exiger le démantèlement d’un régime en fin de vie. Un régime qui a fait de la corruption et l’opacité dans la gestion des affaires publiques sa marque de fabrique et de la répression le mode privilégié de règlement des conflits socio-politiques. Les Algériens sont plus que jamais déterminés à le « dégager » et à prendre leur destin en main. Son cours est, d’autre part, remarquablement pacifique pour une raison double. La première tient aux traumatismes de la violence terroriste de la décennie 1990 qui ont fortement marqué la mémoire collective, y compris celle de la jeunesse, même si elle ne l’a pas vécue, car les traumatismes se transmettent et agissent comme un habitus au sens de Bourdieu. D’où l’insistance des manifestants, dont la jeunesse est le fer de lance, à l’occasion des grandes marches hebdomadaires des mardis et vendredis, sur la silmiya, c’est-à-dire que la lutte doit demeurer pacifique face aux provocations policières. Attitude qui témoigne d’une rupture avec la « culture » de violence des générations précédentes dont la mémoire collective est fortement imprégnée, car irriguée par la référence à la guerre d’indépendance qui était, faut-il le rappeler, d’une violence épouvantable. La seconde en est que la lutte non violente procède d’un choix lucide qui témoigne d’une vision stratégique (6 ). Il s’agit, d’un côté, de reconstruire par des manifestations massives une dynamique citoyenne fédératrice des populations algériennes en opposition aux manœuvres du régime de diviser pour régner, ayant la vie dure.
De l’autre, il est question d’imposer par la mobilisation citoyenne un rapport de force politique suffisamment fort pour faire plier, sans effusion de sang, le haut commandement de l’armée qui dispose d’un appareil répressif redoutable et bien rodé. Aussi, la forte implication des femmes, malgré les intimidations policières du 13 avril 2019 au sein du commissariat de Baraki dans la banlieue Est d’Alger, où des manifestantes furent conduites et contraintes à se déshabiller (7 ), est un facteur déterminant dans la préservation du cours pacifique de la mobilisation. De troisième part, sa longévité exceptionnelle que ni l’arrestation de plus de mille manifestants ni le dispositif sécuritaire impressionnant mis en place particulièrement à Alger, ni le mois de Ramadhan ni la canicule des mois de juillet et août 2019 ne l’ont fait plier. Sous les coups de boutoir d’une mobilisation citoyenne massive et sans répit, le mur de la peur s’est fissuré, et la société, au fur et à mesure que les mardis et vendredis de manifestation s’enchaînaient, a peu à peu pris conscience de sa force et s’est révélée à elle-même. Seule l’irruption inattendue de la pandémie du coronavirus a contraint les Algériens à marquer un arrêt brutal, mais sage et de salubrité publique, après 56 vendredis de mobilisation ininterrompue.
Un ressourcement à l’histoire
Enfin, sa filiation politique avec la révolution de 1954- 1962 ne souffre d’aucune ambiguïté. La révolution pacifique en marche est, en effet, le premier grand soulèvement que l’Algérie a connu et qui s’est approprié de façon aussi franche les idéaux de la guerre d’indépendance. À commencer par la présence remarquée dans les marches de certains héros/héroïnes de la guerre d’indépendance comme Djamila Bouhired, Louisette Ighilahriz, Lakhdar Bouregaâ, Youcef Melouk… et le message exprimé avec force d’Istiqlal (indépendance), ou encore « les généraux à la poubelle et l’Algérie recouvrera son indépendance », c’est-à[1]dire une exigence, sans équivoque, de parachever le processus de libération déclenché en novembre 1954, mais inachevé en 1962, car confisqué dès l’indépendance, selon le juste mot de Ferhat Abbas(8) (premier président du GPRA), par l’armée des frontières. Jean-Pierre Filiu a, d’ailleurs, intitulé, opportunément, son essai paru en décembre 2019 : Algérie, la nouvelle indépendance (9 ). Une pancarte écrite en arabe, arborée par une jeune femme lors d’une manifestation à Alger au cours des premiers mois de l’insurrection, symbolise à elle seule cette filiation : « En 1962 on a libéré le territoire, en 2019 nous libérerons le peuple ». Notons aussi le mot d’ordre central des manifestants « dawla madania machi ‘askaria », soit « un État civil et non militaire », qui fait immédiatement écho au principe soummamien(10) d’août 1956 de la primauté du politique sur le militaire posant ainsi le premier jalon de la construction d’un État civil, mais très vite étouffé dans l’œuf.
L’exhumation de certaines figures de la guerre d’indépendance au premier rang desquelles figurent Larbi Ben M’hidi et Abane Ramdane, lors des grandes marches des mardis et vendredis, n’est en rien fortuite ; ces deux héros incarnaient, au cours des premières années de la guerre de libération, l’opposition au primat du militaire sur le civil. Leur assassinat en 1957, par les généraux parachutistes de l’armée coloniale pour le premier et ses opposants au sein de la direction du FLN pour le second, est un signe annonciateur du projet de militarisation du futur régime politique par l’armée des frontières dès 1962. Le mot d’ordre de la primauté du politique sur le militaire a fait d’autant plus florès dans les marches qu’il a suscité l’ire du haut commandement de l’armée. Dans un discours prononcé le jeudi 7 novembre 2019, le chef d’état-major s’en est ouvertement pris aux milliers, voire millions d’Algériens qui n’ont cessé de le marteler. Il a déclaré que ce mot d’ordre ne repose sur aucune réalité et ne vise qu’à « détruire les fondements de l’État » (11), révélant ainsi l’idée qu’il se fait de l’État qui est, pour lui, synonyme de l’armée.
Ce ressourcement à l’histoire de la guerre d’indépendance montre combien de vieux conflits politiques au sein des instances dirigeantes du FLN imprègnent aujourd’hui encore, plus d’un demi-siècle après, l’agitation en cours dont le Congrès de la Soummam du 20 août 1956, deuxième naissance du 1er novembre 1954, est l’épisode le plus controversé à ce jour. De même que cet enracinement dans l’histoire donne à ce soulèvement une assise politique solide, des repères historiques légitimes et in fine une crédibilité incontestable, car rien de sérieux ne se construit à l’échelle d’une nation sur l’amnésie. Et l’on peut dire dès lors, sans risque d’être démenti, que l’insurrection citoyenne du 22 février s’inscrit en droite ligne des valeurs de la guerre de libération contredisant ainsi le discours des représentants du régime, lesquels, pour se donner une légitimité, se sont érigés en dépositaires exclusifs de l’héritage de la révolution de novembre 1954.
Un mouvement distinct des « printemps » arabes
L’ensemble de ces traits saillants distingue nettement cette insurrection à la fois de toutes les révoltes que l’Algérie a connues depuis 1962 et des « printemps » arabes à l’exemple des mouvements de contestation qui ont secoué des pays comme l’Égypte, la Syrie, la Libye, le Liban, le Maroc… qui se présentent, à vrai dire, comme de brefs « printemps » hâtivement réprimés ou avortés. Le vent de liberté qui a soufflé sur les peuples dans ces pays a suscité tant d’espoirs déçus. Ces hiraks se sont soldés par le renversement de Moubarak en Égypte avant de voir les militaires, après un bref intermède d’un islamiste à la tête de l’État, revenir en force au pouvoir ; la destitution du colonel Kadhafi en Libye, puis son assassinat le 20 octobre 2011, un pays qui a sombré depuis dans le chaos ; une victoire à la Pyrrhus d’Assad en Syrie qui a subi un véritable cataclysme ; l’étouffement et la répression sévère du hirak marocain de 2016, circonscrit cependant à la région du Rif…
À y regarder de plus près, la réalité algérienne est tout autre et le concept de hirak ne suffit pas à rendre compte de ce soulèvement qui s’apparente à certains égards davantage à la situation de la Tunisie, à ceci près qu’en Algérie le processus de contestation, quoique interrompu à cause de la pandémie du coronavirus, est en cours. Aussi présente-t-il, notamment par son cours non violent, certaines affinités électives avec les révolutions qui ont secoué des pays d’Europe centrale et de l’Est à la fin de la décennie 1980, à l’exception toutefois de la Roumanie où Nicolae Ceaușescu fut exécuté en décembre 1989. Révolutions douces, qualifiées aussi de démocratiques, ayant précipité la chute, l’un après l’autre, des partis communistes, à l’exemple de la « révolution de velours » en Tchécoslovaquie de novembre et décembre 1989 qui a fait tomber, sans effusion de sang, le parti communiste et mis fin à la république socialiste tchécoslovaque.
En fait, c’est à une véritable épreuve de vérité que l’Algérie est confrontée aujourd’hui, car ce qui est en jeu est irréductible à la résolution des problèmes sociaux économiques, mais bien la refondation des liens substantiels qui lient les citoyens, les régions, les communautés et (re)définissent leur volonté de vivre ensemble. Il s’agit d’une lame de fond dont les retombées sur l’Algérie et même au-delà seront durables. Un mouvement qui restera gravé dans les annales de l’histoire. S’il est bien vrai qu’il a subjugué nombre de peuples, ce soulèvement a créé, paradoxalement, un environnement anxiogène pour tous les régimes autoritaires de la région et particulièrement les monarchies du Golfe et les États de la même sphère géopolitique qui redoutent l’effet de contagion sur leurs sols.
Son impact risque, en effet, de s’étendre à d’autres pays de la rive sud de la Méditerranée, situation qui n’est pas sans rappeler la guerre d’indépendance – première guerre de libération nationale moderne -, qui fut un modèle pour de nombreux peuples en lutte contre la colonisation y compris l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat et le Congrès National Africain de Nelson Mandela. Mais une révolution, faut-il le préciser, n’est véritablement révolution libératrice que si elle est menée à son terme. Bien que les acquis soient déjà nombreux et tangibles, le régime politique, principale cible des manifestants, ne s’est pas effondré pour autant.
Devant la détermination des Algériens, les dirigeants multiplient les manœuvres dilatoires (tentatives de division, de manipulation, arrestations…) pour se maintenir. Même si le parcours risque d’être long et semé d’embûches pour venir à bout d’un régime, certes, affaibli, mais disposant encore de ressources, notamment la rente pétro[1]gazière, un appareil répressif bien rodé et de solides soutiens à l’intérieur et à l’étranger. Le haut commandement de l’armée a fait mine de comprendre le soulèvement, mais s’obstine à refuser de céder sur l’essentiel : le démantèlement du régime. Il n’a, en 27 vérité, accompagné le soulèvement à ses débuts, tablant sur son essoufflement après quelques mois de contestation, que pour mieux le détourner de son cours et de son objet en l’utilisant à des fins de succession clanique au sommet de l’État. La hiérarchie militaire n’en est pas à son coup d’essai, puisque soixante ans auparavant elle a détourné le fleuve, pour reprendre le titre évocateur du roman de Rachid Mimouni(12), de la révolution libératrice de novembre 1954.
De toute évidence, il n’y a pas de voie royale pour construire une démocratie et un État de droit, tous deux ne sauraient être réduits à des slogans, ce sont bien de véritables modes de bonne gouvernance dont l’édification requiert de la volonté politique, de la patience et des luttes politiques pacifiques sans relâche. Pour empêcher toute velléité de reprise du Hirak, affaibli, certes, d’abord par la pandémie du coronavirus, la hiérarchie militaire, après trois offres politiques électorales sans succès, massivement boycottées par les Algériens, a choisi la répression comme à son accoutumée en procédant à des milliers d’arrestations et en instrumentalisant de manière éhontée la justice. L’activité des partis, des associations, des syndicats, des ligues des droits de l’Homme est quasiment interdite, les espaces médiatique et politique sont plus que jamais verrouillés, les animateurs du Hirak sont traqués et le régime a montré une fois de plus que la répression est dans son ADN. Jamais auparavant l’appareil répressif dans toute la variété de ses dispositifs (policier, administratif, juridique, judiciaire, médiatique…) n’a été aussi fortement mobilisé pour réprimer un mouvement de contestation pacifique que depuis la reprise du hirak vers la fin de février 2021. Bien qu’affaibli d’abord par la pandémie du coronavirus et surtout par la répression tous azimuts dont il est la cible, le hirak est loin d’être vaincu, il a déjà montré sa capacité de résilience.
Par la clarté de ses revendications et les déclarations publiques de ses animateurs les plus en vue, largement relayées dans les réseaux sociaux et par certains médias à l’étranger, il a remarquablement réussi à dévoiler la nature foncièrement militaire du régime et a redonné aux Algériens l’espérance de construire un État de droit, civil et démocratique. Même s’il est empêché d’investir l’espace public, il a semé l’espoir et continue de travailler en profondeur la société algérienne en marquant d’une empreinte indélébile les consciences et peut renaître, comme un phénix, de ses cendres. Grâce notamment à l’action soutenue de la diaspora qui n’a pas cessé d’œuvrer sans relâche à amplifier l’écho du Hirak à l’étranger, à sensibiliser l’opinion publique et les ONG de défense des droits de l’Homme tant en France et en Europe qu’en Amérique du Nord, le Hirak est aujourd’hui non seulement connu et apprécié un peu partout dans le monde, mais aussi et surtout, il est reconnu aussi bien par les ONG de défense des droits de l’homme que des organismes onusiens en charge des mêmes questions.
La priorité présentement est d’agréger les convergences des luttes démocratiques et des solidarités, de poursuivre le travail d’information et de sensibilisation de l’opinion publique et de solliciter régulièrement les ONG et les organismes onusiens de défense des droits de l’homme sur la répression et les violations massives des droits humains.
Tahar Khalfoune, universitaire
1 Lors de cette rencontre baptisée spécieusement « colloque de conscientisation », à Mostaganem dans la commune de Sidi Lakhdar ; celle-ci a assuré l’hébergement de la trentaine de participants et la gendarmerie leur sécurité. Il était question de la mise en place de milices anti-kabyles pour empêcher l’ascension supposée de ces derniers. Voir le quotidien en ligne www.lematindalgerie.com du 8 septembre 2019. 2 Le quotidien El Watan du 16 octobre 2019.
2 Le quotidien El Watan du 16 octobre 2019.
3 Rachid Ouaissa, « Le hirak échappe aux théories classiques des mouvements sociaux », Liberté du 17 février 2020.
4 Cherif Bennadji, « Algérie 2010 : l’année des mille et une émeutes », L’Année du Maghreb, VII, CNRS Éditions, 2011, pp. 263-269.
5 Déclaration au quotidien Liberté du 19 octobre 2019 de Krystyna Dodds, porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères.
6 Jean-Pierre Filiu, Algérie, la nouvelle indépendance, Paris, Éditions du Seuil, décembre 2019, p. 25. 7 Le quotidien Tout Sur l’Algérie (TSA) du 14 avril 2019.
8 L’indépendance confisquée, 1962-1978, Flammarion, Paris, 1984, 240 pages
9 Algérie, la nouvelle indépendance, Paris, Éditions du Seuil, décembre 2019, 167 pages. 10 Voir « Les assises de la Soummam : 60 ans après, quelles leçons ? », publication des actes du colloque international des 25 et 26 août 2016, publication coordonnée par Tahar Khalfoune, Éditions El Ibriz, Alger, 2018, 223 pages.
11 « Algérie : l’armée dénonce le slogan « État civil, pas militaire des manifestants », in le Figaro du 7 novembre 2019.
12. Rachid Mimouni, Le fleuve détourné, Robert Laffont 1982, 218 pages.


